Le temps n’est pas un tapis roulant dont la vitesse croît à mesure que l’environnement technologique crée l’illusion de son accélération et nous ne sommes pas ses cobayes condamnés à courir toujours plus vite pour le rattraper. Si vous vous reconnaissez dans ces lignes, alors cette chronique est pour vous. Je parlerai ici des livres ou des manifestions artistiques, à contretemps parce que justement le temps m’a manqué, pour rendre compte en « temps et en heures » ! Mais temps ordinaire qui « ne se rattrape guère » comme le chantait Barbara, est-il pour autant perdu ? Oui, si on le range dans la catégorie de l’événementiel dont les marqueurs sont les dates avant que tombe le couperet de leurs préemptions. Non, si on l’envisage comme le nécessaire pas de côté, tel un couloir qui borde le tapis roulant et dont le rythme est celui des « heures ». Ce temps-là c’est celui qui met en adéquation le temps intérieur avec le temps de la terre et celui des saisons.
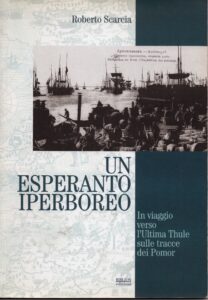 Pour inaugurer cette nouvelle chronique, j’ai souhaité rendre hommage à un collaborateur et un ami fidèle dont les lectrices et les lecteurs de ce site sont familiers. Robert Scarcia, journaliste globe-trotter devant l’Éternel, correspond merveilleusement à cette catégorie du « chroniqueur anachronique », car il chronique, non pas l’événement à proprement dit, mais ce qui le fait advenir. : la langue. À cet égard, il se trouve toujours à la frontière au sens propre comme au sens figuré. Frontière des disciplines, mais aussi des pays. J’en veux pour preuve ses deux ouvrages publiés presque au même moment que je recense avec un retard certain et non, bien sûr, sans un certain remords ! Un Esperanto Iperboreo, un viaggio verso l’ultime Thulé sur les tracce dei Pomor, publié aux éditions Biblion par l’association italienne du Cercle polaire et Correspondencias de Nueva Granada 2008 publié aux éditions Cafascarina en langue originale.
Pour inaugurer cette nouvelle chronique, j’ai souhaité rendre hommage à un collaborateur et un ami fidèle dont les lectrices et les lecteurs de ce site sont familiers. Robert Scarcia, journaliste globe-trotter devant l’Éternel, correspond merveilleusement à cette catégorie du « chroniqueur anachronique », car il chronique, non pas l’événement à proprement dit, mais ce qui le fait advenir. : la langue. À cet égard, il se trouve toujours à la frontière au sens propre comme au sens figuré. Frontière des disciplines, mais aussi des pays. J’en veux pour preuve ses deux ouvrages publiés presque au même moment que je recense avec un retard certain et non, bien sûr, sans un certain remords ! Un Esperanto Iperboreo, un viaggio verso l’ultime Thulé sur les tracce dei Pomor, publié aux éditions Biblion par l’association italienne du Cercle polaire et Correspondencias de Nueva Granada 2008 publié aux éditions Cafascarina en langue originale.
On aurait tort de classer ces deux courts ouvrages (l’une en langue espagnole et l’autre en langue italienne) dans la catégorie des ouvrages spécialisés. Ce sont en fait une série d’articles journalistiques fort accessibles, y compris pour ceux ayant une connaissance relative de ces deux langues. Le cours actuel des événements leur confère malgré tout une étonnante actualité qui confirme, s’il en est, a posteriori, le flair de Scarcia.
Les Pomors (signifiant « habitants des bords de mer ») sont des colons russes, souvent d’ascendance norvégienne et venant de la république de Novgorod. Ils vécurent principalement sur le littoral ou dans le bassin de la mer Blanche. C’est à eux que l’on doit la découverte et le maintient de la route maritime entre Arkhangelsk et la Sibérie. Grâce à leurs navires, les koches, les Pomors pénètrent les régions de l’Oural du Nord et développent les routes sibériennes ; aujourd’hui si stratégiques. Ce peuple du cercle polaire longtemps indépendant de la Moscovie se distinguait autant par le commerce qu’ils pratiquaient que par les rites religieux d’abord païens avant d’être orthodoxe. L’historien arabe du Xe siècle Ibn Fadlan fut l’un des premiers à relater leurs rituels mortuaires ainsi que le panthéon païen qu’ils partageaient avec les Vikings et dont les divinités et les rites finiront par imprégner durablement l’imaginaire russe jusqu’en retrouver les traces chez les romanciers comme Nabokov, les cinéastes contemporains. Pouchkine en fut influencé, comme l’illustre un long poème traduit en italien par le père de l’auteur.
Lorsque Roberto Scarcia va à la rencontre du peuple Pomor dans la première dizaine de ce siècle, ils étaient 6571 locuteurs dans l’Oblast Arkhangelsk et 127 dans l’Oblast de Mourmansk. C’est en ethnologue qu’il entreprend de relater leur tumultueuse histoire. Assez tôt le commerce très intense des céréales et du poisson avec la Norvège voisine favorise la naissance d’une langue métissée, un pidgin appelé le « Russennorsk » qui sera utilisé le long de la côte entre 1750 et 1920.
Pomor, ou la géopolitique de la langue
Ce pidgin du nord sera le fil rouge de la dernière partie de l’ouvrage, la plus passionnante, car les considérations qu’en tire notre journaliste anthropologue ne se bornent pas à la linguistique, elles débouchent directement sur la géopolitique la plus actuelle. C’est la grande originalité de l’approche transdisciplinaire développée par Scarcia. À cet égard, il s’inscrit dans la lignée du sociolinguiste Henri Gobard dont Gilles Deleuze fit l’éloge et qui ne craignait pas de croiser le fer pour défendre une approche stratégique de la langue. Comme son illustre devancier, Scarcia considère non pas les structures de la langue, mais les fonctions. Car la langue est le point aveugle de la guerre hybride qui se déroule actuellement et plus encore, la partie immergée du iceberg (c’est le cas de le dire !) de la guerre culturelle en cours entre l’Europe et les États-Unis.
Scarcia ne craint pas de bifurquer de son objet d’études pour nous en faire entrevoir toutes les conséquences. La question se pose dès lors brûlante : quelle est la langue neutre, la lingua franca, qui permettrait de négocier politiquement les conflits actuels ? Le Russennorsk issu du commerce entre la Norvège et la Russie aurait pu déjà aplanir leurs contentieux régionaux entre ces deux pays. Mais la cause est entendue. Comme pour le reste du monde. Aujourd’hui il n’y a plus de lingua franca si ce n’est le globish qui sert uniquement aux transactions commerciales. L’anglais standardisé qui a détrôné le français comme langue de la diplomatie donne de facto un net avantage à l’anglosphère et, au premier rang desquels, les États-Unis. Avec l’anglais, les États-Unis « jouent à la maison avec le reste du monde ; ils peuvent décider unilatéralement ce que l’on veut comprendre et ce que l’on ne veut pas comprendre et donc à déterminer les critères de ce qui est valide ou pas. Ils peuvent transformer la langue à volonté avec leur néologisme et leur jeu de mots, ce qui équivaut à changer les règles du jeu au milieu du gué ».
C’est précisément ce à quoi nous assistons aujourd’hui ! Avant de vouloir se payer en nature (Groenland, terres rares, pétrole…) Donald Trump se paie de mots. C’est par le jeu du langage qu’il joue avec la planète. Or dans ce jeu, là il n’a pas de parité. Seul compte celui qui a les cartes du langage en main. La conclusion de l’auteur est imparable : « sommes-nous sûrs que l’enseignement de l’anglais conduit par les « native speakers » n’aboutit à faire du monde non anglophone qu’esclave culturel et de limiter la langue qu’aux affaires ? Avec en sous-texte cette injonction : « faites de l’argent, mais ne rêvez pas de faire de la culture et encore moins de la politique ».
Mujeres de la frontera
 Scarcia sait de quoi il parle pour avoir enseigné des années durant l’anglais aux quatre coins du monde (en Inde, en Russie) et notamment en Amérique du Sud. En 2008, il se trouve une autre fois à la frontière et pas n’importe laquelle : celle entre le Venezuela, la Colombie et l’Équateur où affluent de nombreux réfugiés qui fuient la violence. À l’époque, la guerre entre le gouvernement colombien et les FARC fait rage, mais il y a aussi de troubles au Panama auquel s’y ajoutent les violences des Narcotrafiquants. Scarcia y vient enseigner l’anglais par le biais du programme du Jesuit refugee Service. Toutefois, c’est en espagnol qu’il écrira ces dix-sept correspondances. Son talent de journaliste s’y déploie alors avec force et minutie. Il y décrit la vie de ces déplacés, leur combat au jour le jour pour défendre leurs droits, leur témoignage sans ne jamais oublier de les ancrer dans leur histoire et leur littérature. Le titre des articles sont déjà éloquent : L’immigration équatorienne et le nuage du Chimborazo, les limbes migratoires de l’Équateur et la boîte de Pandore, les pécheurs du pacifique et le passage de Mataje, la mémoire du « caracazo », la coopérative de Hugo Chavez et l’expérience du « Père Dorre », les femmes en marche, Panama plus qu’un canal, cité des calvaires. On y retrouve les thématiques chères à l’auteur ; la langue bien sûr, et notamment son combat pour un anglais dénationalisé de son pouvoir impérial, mais aussi pour l’immigration et le socialisme chrétien dans lequel il trouve sa curiosité et sa foi dans l’humanité. « Ce qui manque aux autorités de Panama ; de Quito et de Caracas, ce sont des des projets d’intégrations transfrontaliers, de projets qui tiennent compte de la réalité de la frontière, entendue comme espace commun, permettant des relations binationales ou multinationales favorables au développement politique et culturel entre nations et non l’inverse, comme lieu de séparation et de conflit. » Conclut-il dans son dernier papier au titre prémonitoire : « Futurologie de l’enfer ou frontières du salut ? »
Scarcia sait de quoi il parle pour avoir enseigné des années durant l’anglais aux quatre coins du monde (en Inde, en Russie) et notamment en Amérique du Sud. En 2008, il se trouve une autre fois à la frontière et pas n’importe laquelle : celle entre le Venezuela, la Colombie et l’Équateur où affluent de nombreux réfugiés qui fuient la violence. À l’époque, la guerre entre le gouvernement colombien et les FARC fait rage, mais il y a aussi de troubles au Panama auquel s’y ajoutent les violences des Narcotrafiquants. Scarcia y vient enseigner l’anglais par le biais du programme du Jesuit refugee Service. Toutefois, c’est en espagnol qu’il écrira ces dix-sept correspondances. Son talent de journaliste s’y déploie alors avec force et minutie. Il y décrit la vie de ces déplacés, leur combat au jour le jour pour défendre leurs droits, leur témoignage sans ne jamais oublier de les ancrer dans leur histoire et leur littérature. Le titre des articles sont déjà éloquent : L’immigration équatorienne et le nuage du Chimborazo, les limbes migratoires de l’Équateur et la boîte de Pandore, les pécheurs du pacifique et le passage de Mataje, la mémoire du « caracazo », la coopérative de Hugo Chavez et l’expérience du « Père Dorre », les femmes en marche, Panama plus qu’un canal, cité des calvaires. On y retrouve les thématiques chères à l’auteur ; la langue bien sûr, et notamment son combat pour un anglais dénationalisé de son pouvoir impérial, mais aussi pour l’immigration et le socialisme chrétien dans lequel il trouve sa curiosité et sa foi dans l’humanité. « Ce qui manque aux autorités de Panama ; de Quito et de Caracas, ce sont des des projets d’intégrations transfrontaliers, de projets qui tiennent compte de la réalité de la frontière, entendue comme espace commun, permettant des relations binationales ou multinationales favorables au développement politique et culturel entre nations et non l’inverse, comme lieu de séparation et de conflit. » Conclut-il dans son dernier papier au titre prémonitoire : « Futurologie de l’enfer ou frontières du salut ? »
Vous l’aurez compris, Robert Scarcia appartient à la catégorie des grands reporters humanistes, soucieux d’inscrire leur reportage dans le fil de l’histoire, de la justice sociale et de la littérature. A bon entendeur, salut !
